Votre panier est vide
Besoin d'inspiration ?
Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais
Article -

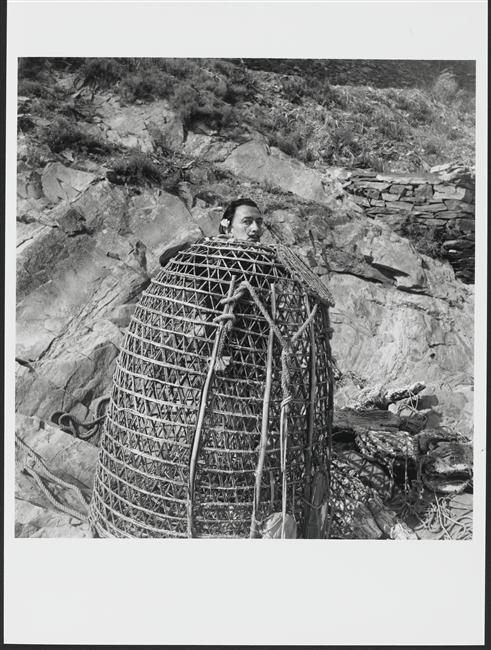
Du dadaïsme au surréalisme
A l’origine, le surréalisme est avant tout un mouvement littéraire dont le noyau est constitué dès 1919 autour de la revue Littérature fondée par Breton, Soupault et Aragon.
D’abord intéressé par l’esprit révolutionnaire qui anime Tzara, Breton commence par se rallier au dadaïsme avant de rompre, dès 1923, avec des positions qu’il juge trop négatives : il publie des manifestes anti-Dada tels que Lâchez tout et sabote la soirée « Le Cœur à Barbe » organisée par Tzara. Une fois cette rupture consommée, il réplique en constituant son propre mouvement et publie, en 1924, le fameux Manifeste du surréalisme, dans lequel il se réapproprie le terme qu’Apollinaire inventa en 1917 après avoir vu Parade (ballet expérimental réunissant Diaghilev, Cocteau, Satie et Picasso). Il en donne la définition suivante : « Surréalisme : n. m., automatisme pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre façon, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale ».
Votre panier est vide
Besoin d'inspiration ?
Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais
Voir le contenu : Le retour des grandes expositions au Grand Palais : ce qui vous attend dès le mois de juin !

Aloïse Corbaz, dite Aloïse, Collier en serpent, vers 1956
Article -
À vos agendas ! Le Grand Palais vous accueille dès le mois de juin avec une programmation riche et festive. Grandes expositions, spectacles vivants, installations immersives, fêtes populaires, expériences artistiques : découvrez vos rendez-vous incontournables de l’été !
Voir le contenu : Le Salon Seine : bientôt nouveau terrain de jeu pour les familles

Article -
Dès le 6 juin, le Grand Palais invite les familles à pousser la porte d’un nouvel espace en accès libre et gratuit : le Salon Seine, un lieu de 900 m² baigné de lumière et pensé pour vivre l’art autrement. Avec une installation interactive, un comptoir...
Voir le contenu : Le Grand Palais se métamorphose, grandpalais.fr aussi : tout ce qui a changé

Article -
Votre site grandpalais.fr évolue pour proposer une navigation optimisée et un accès simplifié aux expositions, évènements et ressources du Grand Palais. Qu'est-ce qui a changé exactement ? On vous explique.